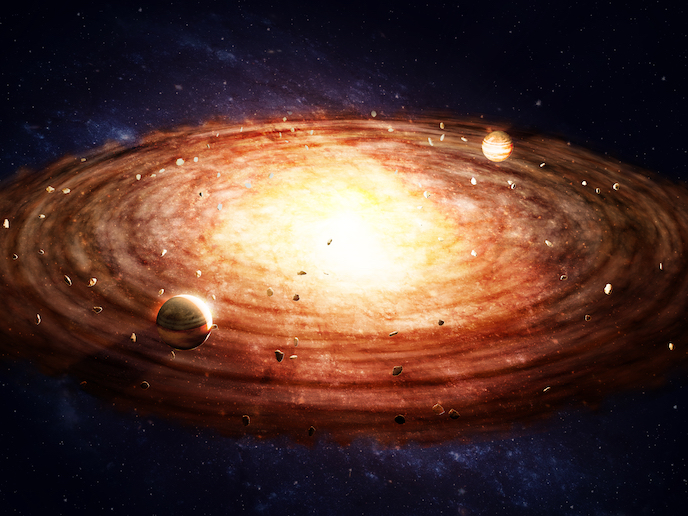Combiner des technologies de communication, de suivi et d’IA pour des interventions d’urgence plus intelligentes
Même si la technologie de positionnement GNSS (système global de navigation par satellite) est en mesure d’aider les secouristes à améliorer leur efficacité opérationnelle, il reste certains défis à relever. Pour les pompiers travaillant à l’extérieur, des obstacles tels qu’une fumée épaisse, des forêts denses ou un terrain accidenté compromettent la disponibilité, la fiabilité et la précision des données satellitaires. Les signaux GNSS sont également mal reçus à l’intérieur des bâtiments et ne sont généralement pas disponibles sous terre. L’obtention d’informations spécifiques à un lieu dépend souvent des observations des pompiers, ce qui représente pour eux un fardeau supplémentaire compte tenu des autres tâches stressantes et dangereuses qui leur incombent. Le projet AIOSAT (Autonomous Indoor & Outdoor Safety Tracking system), soutenu par l’UE, a mis au point un système qui combine plusieurs technologies afin d’améliorer la disponibilité et la précision des informations de positionnement aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments, pour aider les pompiers. «Ces technologies de positionnement permettent à notre algorithme de produire des informations précieuses qui aident les premiers intervenants et les contrôleurs opérationnels à prendre des décisions plus éclairées, améliorant ainsi la protection des personnes et des biens», explique Iñigo Adin, coordinateur du projet chez Ceit, qui en est l’hôte.
Une localisation précise
L’algorithme au cœur du système AIOSAT repose sur une combinaison de données provenant de trois technologies de positionnement. Le GNSS, complété par le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et par une version adaptée du service d’accès aux données EGNOS, fournit des informations relatives au positionnement par satellite. Les capteurs des centrales inertielles intégrées à des unités portées par les pompiers permettent à l’algorithme d’anticiper les mouvements et la direction de leur corps. Le système s’appuie sur la technologie des radiofréquences à bande ultra-large, qui détermine les distances entre chaque unité, ou «nœud». Intégrés dans les combinaisons et les bottes des pompiers, ces nœuds transmettent des données, portant notamment sur la position, l’état de charge de la batterie et la température vers le nœud du chef de brigade, à l’aide du Bluetooth et de LoRa, un réseau étendu à faible puissance. Ces données sont ensuite envoyées au serveur cloud grâce à la technologie 3G/4G. Outre les données de suivi et d’alerte provenant des nœuds des pompiers, le serveur contient un certain nombre de ressources, notamment des applications visuelles, qui s’avèrent utiles pour le partage d’informations et la transmission des ordres. Les responsables des postes de commandement des interventions peuvent accéder en ligne aux informations de la base de données et rester connectés aux tablettes et aux smartphones portés par les chefs de brigade déployés au sein de chaque équipe. Les pompiers et les chefs de brigade ont également la possibilité télécharger des mises à jour situationnelles sur le serveur. «La prise de décision est ainsi plus rapide, plus efficace et plus transparente. Étant donné que l’ensemble du processus est enregistré, il est possible de le réexaminer à des fins de formation», fait remarquer Iñigo Adin.
Sauver des vies et préserver des moyens de subsistance
Les trois scénarios de test suivants ont été élaborés pour valider le système: les conditions extérieures d’un scénario rural en Estrémadure, en Espagne; un parking souterrain à Gand, en Belgique; et les conditions mixtes urbano-industrielles du Twente Safety Campus à Enschede, aux Pays-Bas. Alors que les travaux menés sur ces trois sites avaient déjà permis de parfaire la configuration du système, la pandémie de COVID-19 a ralenti les essais. Pour continuer sur son élan, le consortium a reproduit ces scénarios pour une série de tests finaux menés à Saint-Sébastien, Séville et Enschede. «Les résultats de ces scénarios ont validé la précision de nos simulations, en démontrant que la fusion des trois technologies de positionnement offrait une solution adaptée aux pompiers», explique Iñigo Adin. Le consortium AIOSAT a pour objectif d’accorder une licence à une entreprise en vue d’intégrer le système dans un dispositif commercial. Les membres prennent actuellement contact avec des entreprises potentielles, partagent les résultats du projet et proposent leur expertise.
Mots‑clés
AIOSAT, satellite, pompier, intervention d’urgence, algorithme, technologie radio, suivi, positionnement, technologie, capteurs, sécurité