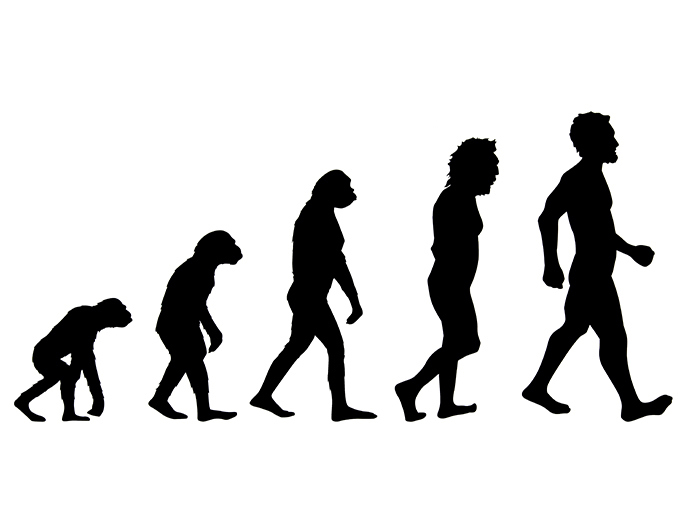Le microbiome a-t-il joué un rôle dans l’histoire de l’élevage laitier?
Lorsqu’ils sont jeunes, tous les êtres humains sont capables de digérer le sucre du lait, c’est-à-dire le lactose. Toutefois, en vieillissant, nous cessons progressivement de produire de la lactase, l’enzyme qui décompose le lactose. Il s’agit d’une étape naturelle du processus de sevrage propre à tous les mammifères. Pourtant, certaines populations ont connu des mutations dans la région génétique qui contrôle la production de lactase, mutations qui pérennisent la production de cette enzyme tout au long de la vie, de l’enfance à l’âge adulte. Les personnes qui présentent de telles mutations sont appelées «lactase persistantes». La proportion d’individus concernés par ce phénomène varie dans le monde. Les taux les plus élevés de personnes lactase persistantes se trouvent en Scandinavie et dans les Îles Britanniques, où plus de 80 % des gens présentent cette caractéristique. En Asie occidentale, 20 à 70 % des individus sont lactase persistants, alors que la plupart des autres populations asiatiques présentent des taux de l’ordre de 0 à 20 %. Quelles sont les causes de cette disparité? Et pourquoi la recherche montre-t-elle qu’il s’est écoulé des millénaires entre le début de l’élevage laitier et le développement des mutations génétiques à l’origine de la persistance de la lactase? Le microbiome a-t-il joué un rôle? «La production laitière est une pratique vieille de plusieurs millénaires et certaines populations ont développé des modes de vie qui dépendaient presque entièrement de cette production plus de 1 000 ans avant l’apparition des mutations liées à la persistance de la lactase», explique Christina Warinner, chercheuse principale du projet aujourd’hui basée à Harvard, aux États-Unis. Les raisons d’un tel écart temporel et la manière dont les populations néolithiques, dépourvues de lactase, digéraient les produits laitiers restent un véritable mystère. «Je suppose qu’elles pouvaient digérer le lait, mais peut-être d’une manière différente, peut-être grâce à un microbiome intestinal adapté», note Christina Warinner. Avec le soutien du Conseil européen de la recherche, le projet DAIRYCULTURES a entrepris de répondre à ces questions intrigantes en concentrant ses recherches sur la Mongolie, où l’élevage laitier est pratiqué depuis plus de 5 000 ans.
Identifier le développement de la persistance de la lactase grâce au génotype
Pour suivre la diffusion des technologies laitières en Asie, DAIRYCULTURES a extrait des protéines de la plaque dentaire calcifiée de centaines d’anciens individus en Azerbaïdjan, en Chine, en Mongolie et en Russie. Grâce à la spectrométrie de masse en tandem, l’équipe a pu identifier la présence de protéines du lait, ce qui a permis de confirmer la consommation de produits laitiers. «Nous avons utilisé la datation au radiocarbone pour confirmer l’âge des individus, et des technologies d’étude de l’ADN ancien pour reconstituer le génome de bon nombre d’entre eux.» Cela a permis à l’équipe d’établir des génotypes en fonction de la persistance de la production de lactase. Le projet a également examiné les liens de parenté et reconstitué les itinéraires de migration de ces peuples. Parallèlement, les chercheurs ont utilisé des techniques d’analyse de l’ADN ancien pour étudier leur bétail et retracer les voies de migration et de commerce des bêtes à mesure que les populations laitières se sont répandues vers l’est de l’Asie. Une fois cette étape franchie, l’équipe a pu cartographier la diffusion préhistorique des technologies laitières en Asie et établir des liens avec les déplacements de groupes de personnes spécifiques. «Nous avons constaté que la persistance de la production de lactase ne jouait qu’un rôle minime, voire nul, dans l’élevage laitier au début de la préhistoire; d’autres facteurs et adaptations devaient donc intervenir», ajoute Christina Warinner, qui a mené ses recherches au sein de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste, en Allemagne.
Le rôle du microbiome dans la digestion du lactose
L’équipe avait déjà récupéré et séquencé l’ADN microbien de paléofèces provenant de régions de l’ancienne Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie occidentale. Cela a permis de reconstituer les microbiomes intestinaux des anciens peuples de ces régions. «Malheureusement, nous n’avons pas encore collecté de paléofèces dans les régions concernées par l’élevage laitier. Ce projet vise plutôt à caractériser les variations microbiennes dans les microbiomes intestinaux de personnes vivant aujourd’hui de l’élevage laitier de subsistance et à les comparer à des sociétés qui ne pratiquent pas ce type d’élevage», ajoute Christina Warinner. Plus précisément, le projet a étudié les microbiomes intestinaux de bergers laitiers nomades de Mongolie qui ne sont pas lactase persistants. Christina Warinner explique: «Nous espérons qu’en étudiant leurs microbiomes intestinaux, nous obtiendrons des indices sur la manière dont les microbes ont pu faciliter la digestion du lait dans les populations anciennes.»
Travailler avec les éleveurs d’aujourd’hui pour raconter l’histoire de leurs ancêtres
«Il est extrêmement intéressant d’utiliser les technologies protéomiques pour reconstituer le régime alimentaire des peuples anciens. Nous faisons de nouvelles découvertes tous les jours, et lorsque nous identifions des protéines alimentaires dans le tartre dentaire d’un individu ancien, c’est comme si nous étions transportés des milliers d’années en arrière.» Pour Christina Warinner, connaître un détail aussi intime de la vie quotidienne d’une personne ayant vécu il y a des millénaires est une chose étonnante. «C’est un honneur de pouvoir utiliser ces connaissances pour reconstituer les modes de vie de sociétés anciennes, et cela permet faire le lien entre les gens d’aujourd’hui et ceux qui vivaient il y a des milliers d’années. Les éleveurs mongols contemporains sont souvent étonnés d’apprendre que les technologies laitières qu’ils utilisent font partie d’une tradition vieille de 9 000 ans et qu’ils sont les gardiens de ce précieux patrimoine culturel.»
Mots‑clés
DAIRYCULTURES, lactase persistant, lait, microbiome, bergers, Mongolie, élevage laitier préhistorique, digestion du lactose, génotype